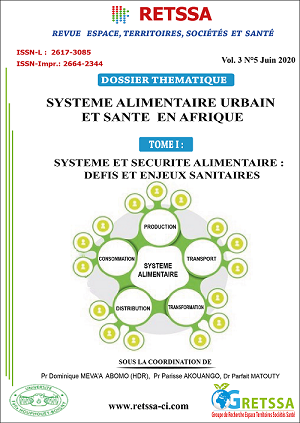13 |FACTEURS DE LA VULNERABILITE ALIMENTAIRE DES REFUGIES CENTRAFRICAINS ET STRATEGIES D’ADAPTATION DANS LE DEPARTEMENT DE LA NYA-PENDE AU TCHAD
FACTORS OF THE FOOD VULNERABILITY OF CENTRAL AFRICAN REFUGEES AND ADAPTATION STRATEGIES IN THE NYA-PENDE DEPARTMENT IN TCHAD
Mots-clés:
Vulnérabilité alimentaire| réfugiés centrafricains| nya-pendé| Stratégies d’adaptation|Résumé
L’environnement socio-politique, du Tchad montre que les possibilités d’autosuffisance des réfugiés sont limitées. Ces derniers sont exclus du marché du travail formel et n’ont pas accès aux besoins sociaux de base. Cette étude a identifié et analysé les facteurs de la vulnérabilité alimentaire des réfugiés et les stratégies d’adaptations dans le département de la nya-pendé. Pour y parvenir, la méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié a permis d’enquêter 80 ménages réfugiés dans les camps de Doholo, Gondjé, Amboko et Dosseye. L’analyse des données collectées a été faite par la méthode de statistique descriptive. Les résultats montrent que les principaux facteurs de la vulnérabilité alimentaire dans le Département de la Nya-Pendé sont d’ordre socio-structurel, conjoncturel, naturel et technique. L’on relève ici une stratégie alimentaire du PAM déficitaire et les faibles rendements agricoles. Face à ces facteurs, les populations vulnérables développent quelques stratégies d’adaptation. Les réfugiés travaillent dans plusieurs secteurs qui fournissent des biens et des services socio-économiques afin d’avoir les moyens de subsistance minimale. Il s’agit de l’agriculture, l’élevage, le commerce, la vente des biens productifs ou non, l’achat à crédit ou l’emprunt, l’épargne du ménage, le déstockage des animaux et le recours à la mendicité.
Introduction
La problématique des réfugiés préoccupe plusieurs chercheurs aujourd’hui. Ainsi, cette question reste au cœur de nombreuses discussions tant sur le plan national qu’au niveau de la géopolitique mondiale. Depuis les années 1950, plusieurs États occidentaux, tel que la Suisse jusqu’en 1995, disposait des contingents leur permettant d’accueillir un certain nombre de réfugiés en provenance des pays voisins. O. Clochard, et K.D. Mohammed (2005, p.46). Ces réfugiés sont installés dans les camps gérés par le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Mais, dans les pays les plus pauvres et en Afrique en particulier, rare sont les États pouvant assumer seuls la lourde charge que représente l’accueil de dizaines, voire de centaines de milliers de ces réfugiés surtout au plan alimentaire, L. Cambrezy, (2006, p. 366)
Plusieurs citoyens sont contraints de quitter leur pays, en raison soit de leur origine, soit de leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques, R. Adaha, (2009 p.46). L’instabilité politique et les conflits armés de la République Centrafricaine (RCA) en mars 2013 ont ainsi entraîné un regain d'insécurité ; et forcé à l'exil des milliers de personnes sinistrées des villages frontaliers. Ces personnes parties pour la plupart du Nord de la RCA (notamment de Nanamembéré, Bémal, Ombélla-Poko, Markounda, etc…) se sont installées au Tchad et au Cameroun. En 2013, environ 30 000 personnes se sont réfugiées dans quatre camps (le canton Goré et Timbéri) et six sites créés par l’UNHCR (le canton Békan) dans le département de la Nya-Pendé situé au sud du Tchad.
Cet afflux considérable des réfugiés dans ledit département a entrainé des difficultés d’accès à l’alimentation. L’intervention des pouvoirs publics et privés, en matière des moyens de subsistance et d’inclusion économique des populations reste insuffisante ou limitée. Cette faiblesse s’observe avec l’insécurité alimentaire dès le début de cette décennie dans la majeure partie des territoires du Tchad. La situation est perceptible et préoccupante sur l’ensemble des camps des réfugiés du département, (Protection Civile et Opérations d’Aide Humanitaire Européennes, 2017, p. 4).
La vulnérabilité alimentaire désigne une couche de la population qui ne parvient pas à satisfaire l’ensemble de ses besoins, même en conjoncture, D. Ouedraogo, M. Kabore, et B. Kienou (2007, p.6). Une légère crise peut faire basculer un ménage dans l’insécurité alimentaire. Elle est étroitement liée à la notion de moyens de subsistance et de la stratégie d’adaptation d’un ménage.
Cependant, le dysfonctionnement des structures publiques et la capacité limitée des Organisations Non Gouvernementales en charge de la gestion des réfugiés du département se sont accrus. Ces difficultés ont progressivement plongée les réfugiés dans une vulnérabilité alimentaire. Les interventions en matière des moyens de subsistance et d’inclusion économique des réfugiés et populations hôtes s’avèrent urgentes. Ces moyens de subsistance comprennent entre autres ; le développement des colonies agricoles, l’élevage, le commerce, la chasse par les réfugiés du département de la Nya-Pendé dans le but de maintenir l’équilibre alimentaire au sein des ménages.
Le département de la Nya-Pendé fait partie intégrante des six (6) unités administratives qui forment la province du Logone Oriental. Son chef-lieu est Goré. Situé entre 7° 30’ et 8° 28’ de latitude Nord ; 16° 15’ et 17° 15’ de longitude Est, il est limité au Nord par le département de la Nya, au Sud par la RCA, à l’Est par le département de Kouh-Ouest et enfin à l’Ouest par le département des Monts de Lam (Carte n°1).
Carte n°1 : Localisation de la zone d’étude
Le département de la Nya-Pendé couvre une superficie de 4 523 km² et peuplé d’une population de 108 090 habitants (2e Recensement Général de la Population, 2009). Aux latitudes tendant vers les régions équatoriales, sa situation géographique favorable est le résultat des conditions pluviométriques favorables et des conditions physiques satisfaisantes (sols riches, réseau hydrographie dense, végétation assez abondante). Ces paramètres physiques font de cette zone, un milieu très convoité pour l’agriculture ; terre d’accueil des réfugiés.
La mise en valeur des terres et les activités agropastorales sont les principaux facteurs qui favorisent l’adaptation. Il faut ajouter à cela, le projet d’aide d’urgence à l’élevage et à la crise alimentaire financé par la Banque mondiale (BM) en 2018. Face à la vulnérabilité alimentaire, les réfugiés du département aménagent des terres cultivables, pratiquent de l’élevage et le commerce. Au regard de cette situation, il est important de s’intéresser aux impacts des activités, voire aux dynamiques qu’elles entrainent au sein des ménages vulnérables.
Méthodologie
1. Méthodologie
Pour mener cette étude, une recherche documentaire a été réalisée afin d’appréhender les concepts et les théories sur la sécurité, l’insécurité alimentaire et aux stratégies d’adaptation des réfugiés. Cela a permis de prendre connaissance du niveau d’avancement de la recherche scientifique sur cette étude. Cette étape a été suivie des enquêtes de terrain afin d’avoir les données de première main ou de sources primaires. Les guides d’entretiens, les observations directes et les questionnaires constituent les principaux outils utilisés. Ces questionnaires et guides d’entretiens ont été administrés auprès des réfugiés et des personnes ressources (autorités administratives, les chefs traditionnels, responsables d’organisations) impliqués dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptations des réfugiés à la vulnérabilité alimentaire du département de la nya-pende. L’étude s’est en partie basée sur des données collectées auprès des ONG en charge des réfugiés (Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Programme Alimentaire Mondial (PAM)).
Cette étude portant sur la problématique de la vulnérabilité des moyens de subsistance des réfugiés, il s’est agi dans le cadre de l’échantillonnage, de sélectionner aléatoirement parmi les personnes réfugiées. Pour y parvenir, un échantillon aléatoire stratifié dans l’espace a été mise en œuvre. Pour déterminer la taille de notre échantillon, nous avons utilisé la méthode aléatoire stratifiée dans l’espace, H. Gumuchian et C. Marois, (2000 p. 122). Cette méthode consiste à prélever 10 % de la population cible lorsque l’étude a lieu en milieu urbain et 20 % en milieu rural. Cette recherche de terrain est effectuée dans les camps des réfugiés (population cible) en milieu rural. Par conséquent, 20 % de la population cible soit 1/5 des réfugiés ont été retenu afin de permettre une bonne représentativité de l’ensemble de la population vulnérable. Ce moyen a permis d’obtenir une taille d’échantillon de 80 ménages de réfugiés sur les 400. Cela correspond à un effectif adéquat pour que les informations collectées dans le cadre de cette étude soient représentatives pour l’ensemble des réfugiés.
Les données issues de l’enquête par questionnaire ont été dépouillées de façon manuelle et les incohérences observées ont été immédiatement corrigées. Par la suite, les opérations de recodage ont permis d’apprêter ces questionnaires à la saisie qui s’est faite à l’aide du masque de saisie élaboré avec logiciel SPSS.20. Le Traitement statistique des données quantitatives dans Excel 2016, a permis de concevoir et de réaliser, les graphiques, ainsi que des tableaux statistiques descriptives.
Résultats
2. Résultats
2.1. Facteurs de la vulnérabilité alimentaire des réfugiés du département de la Nya-Pendé
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), est l'organisme d'aide alimentaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU) actions sont consacrées à l’assistance alimentaire dans les situations d'urgence des communautés et à l’amélioration de leur état nutritionnel, jusqu’aux renforcements de leur résilience. L’assistance du PAM est estimée chaque année à environ 80 millions de personnes dans près de 80 pays (Programme Alimentaire Mondial, 2014). Toutefois, cette assistance demeure insuffisante. Les facteurs de la vulnérabilité alimentaire du département de la Nya-Pendé sont d’ordre socio-structurel, conjoncturel et naturel.
2.1.1. Facteurs structurels et conjoncturels
Dans le département de Nya-Pendé, l’on dénombre 21 448 réfugiés dont 5 852 installés dans les camps de Doholo, Dosseye, Amboko et Gondjé (Protection Civile et Opérations d’Aide Humanitaire Européennes, 2017). Cet afflux des réfugiés est le plus important depuis 2014 et dépasse largement la capacité opérationnelle des organisations humanitaires. En plus on note une pression abusive sur les ressources disponibles. Il ressort des travaux de terrain que les ménages hôtes vivant dans des villages isolés et difficiles d’accès sont sujets à l’insécurité alimentaire à cause de la difficulté d’accès aux approvisionnements et aux assistances multiformes. 22 % de ces ménages sont en insécurité sévère et 60% en insécurité modérée. Les ménages dirigés par les femmes (autochtone ou réfugié), les ménages avec un chef qui ne sait ni lire n écrire ou âgés de plus de 60 ans sont vulnérables par l’insécurité alimentaire ainsi que les ménages monoparentaux (veufs, séparés ou divorcés).
Les enquêtes ont pu également ressortir l’inadéquation de l’aide alimentaire aux habitudes alimentaires des ménages assistés. De ce fait, les ménages au lieu de consommer les vivres issus des dons alimentaires, les vendent pour s’acheter ce dont ils ont besoin. Il faut aussi le fait de la diminution progressive de l’aide alimentaire car le Programme Alimentaire fait face aux retraits de certains bailleurs de fonds. C’est pour essayer de résoudre ce problème que le Programme Alimentaire a muté son aide alimentaire en aide non alimentaire appelé le transfert monétaire. Le but des interventions monétaires est d’aider à créer une augmentation immédiate du pouvoir d’achat afin que la population touchée puisse avoir accès aux produits de base et l’amélioration des actifs d’existence (Action Contre la Faim, 2009). Ce transfert consiste à donner un coupon mensuel de 3 000 F CFA aux chefs de ménage. Ce montant est défini selon la taille du ménage. Un montant de 30 000 FCFA pour la taille de 15 personnes ou de 15 000 FCFA pour un ménage de 5 personnes. Or 98,75% de nos enquêtés utilisent l’argent perçu à d’autres fin et non pour l’achat des vivres.
2.1.2. Facteurs naturels : inondations, sècheresses et invasion des insectes
La pauvreté du sol, l’insuffisance des pluies annuelles, l’inondation ou encore l’invasion des prédateurs (oiseaux, chenilles, animaux sauvages…) sont d’un côté, autant de phénomènes qui empêchent les réfugiés de se livrer aux activités agricoles. L’exploitation abusive d’une parcelle sur une période de 3 à 6 ans, la rend de plus en plus infertile et pauvre à l’agriculture. Selon les données d’enquêtes, 41% déclarent que les facteurs de faible rendement sont dus à l’infertilité du sol. Cependant, 21%, rapportent que l’inondation est un facteur important. Enfin, 14% estiment la mauvaise pluviométrie annuelle est un facteur inévitable des faibles rendements agricoles. Ces faibles rendements ont plongé les réfugiés dans une vulnérabilité en matière d’accès au moyen des subsistances et d’inclusion socio-économique.
2.1.3. Facteurs techniques : usage des outils rudimentaires et faible rendements agricoles
Comme dans la plupart des espaces ruraux Tchadiens, la force de production des réfugiés agriculteurs de la Nya-Pendé est constituée des ménages soit 79%. Ces derniers sont le plus souvent dépourvus d’outils de productions adéquats. En effet, dans le cadre de cette étude, 100% des enquêtés utilisent la houe, le coupe-coupe et la pelle pour cultiver. L’usage de ces instruments rudimentaires explique une faible assistance en qualité et en quantité des réfugiés et des populations hôtes par les structures en charge (UNHCR et PAM) dans le département de Nya-Pendé. La faible assistance au niveau des appuis en matériels serait la conséquence des rendements agricoles insatisfaisants des populations vulnérables de ce département. Ces réfugiés sont naturellement exposés à l’insécurité alimentaire.
2.2. Moyens de subsistance et stratégies d’adaptations des ménages refugiés
2.2.1. Clarification du concept « moyens de subsistance » et son état de lieu dans le département de Nya-Pendé
L’expression « moyens de subsistance » désignent les activités et les ressources qui permettent aux populations de subvenir à leur besoin fondamental, comme manger, boire, se loger et s’habiller (UNHCR, 2014). Ces moyens peuvent notamment provenir des biens humains (connaissances, éducation, capacités de travail, bonne santé), sociaux (relations sociales), naturels (terres, forêts, ressources en eau), physiques (bétail, terres, outils) et financiers (revenus, accès au crédit et aux investissements). C’est l’ensemble des méthodes utilisées par les ménages pour obtenir et conserver l’accès aux produits de première nécessité. Plus un ménage peut recourir à des moyens d’existence variés, moins il sera vulnérable. Les Moyens de subsistance sont la combinaison de toutes les activités (agricoles et non agricoles) composant les ressources (économiques et alimentaires) permettant au ménage d’exister (en subvenant à ses besoins essentiels) et de se développer. En d’autres termes, les Moyens d’Existence comprennent les capacités, composés d'avoir (incluant les ressources matérielles et sociales) et les activités utilisées par un ménage comme moyen de vivre. Les Moyens de subsistance d’un ménage sont assurés lorsqu’il peut faire face au stress et aux chocs, et maintenir ou améliorer ses capacités et ses avoirs productifs, (C. Girard, 2017 p. 6).
Les zones de moyens de subsistance sont des secteurs géographiques dans lesquels les populations partagent le même modèle de moyen de subsistance (même système de production/de commerce/même stratégies de protection). Dans le cadre de cette étude, les moyens de subsistance des ménages regroupent six activités socioéconomiques. En effet, certains réfugiés bénéficient de divers financements humanitaires dans quelques secteurs d’activité économique (Graphique n°2).
Graphique n°2 : Répartition des enquêtés par moyens de subsistance
Source : Enquête de terrain, 2019
D’après cette figure, le commerce (35%) est pour la population réfugié le moyen de subsistance le plus sollicité. Il est à relever que le commerce est une activité que ces réfugiés ont toujours exercée dans leurs pays d’origine. Ensuite l’agriculture (20%) et l’élevage (14%) qui constituent le poumon économique de ce département en particulier, celui du Tchad en général.
2.2.2. Stratégies globales d’adaptations des ménages
La vulnérabilité alimentaire introduit le concept de résilience. C’est l’ensemble des moyens de subsistance disponibles et de la capacité des ménages à résister au choc (L. Nda’, 2014, p.5). Cette définition prend en considération les mesures réduisant le risque des ménages de se retrouver en situation d’insécurité alimentaire et les mesures les aidant à réagir en cas de crise. La stratégie est perçue dans cette étude comme la combinaison des moyens et biens produits ou non, dont disposent les réfugiés pour faire face à la vulnérabilité alimentaire et de l'expression des choix individuels ou collectifs mis en place par la population pour faire à une perturbation ou une crise. C’est en fait l'ensemble des activités auxquelles recourent un ménage ou un groupe de personnes afin de se procurer de la nourriture, des revenus et/ou des services, quand leurs moyens habituels de subsistance ont été perturbés ou sont susceptibles de l'être.
2.2.3. Vente des biens productifs
La vente des matériels agricoles : porte-tout, charrue, houe, coupe-coupe, semences, est une stratégie de vulnérabilité alimentaire développée par les ménages pour se procurer des ressources financières afin d'acheter de la nourriture. Elle est adoptée par 31% des ménages enquêtés, mais c'est une stratégie qui présente un risque car elle met en péril les moyens de subsistance. En effet, les matériels agricoles ont été distribués dans le cadre du projet sécurité alimentaire soit par l’ONG FLM ou soit par le Care aux réfugiés dans ce département. La vente de ces matériels, engendre au sein des ménages qui la pratique des campagnes agricoles pénible du fait du manque des outils et les rends encore plus vulnérable.
2.2.4. Achat à crédit ou Emprunt de vivres
Dans tous les camps, créés par le Haut-Commissariat aux Réfugiés, il existe également des marchés. Les réfugiés fréquentent à la fois le marché du camp, le marché hebdomadaire du village ainsi que le marché local du canton pour se faire des stocks alimentaires et de se familiariser avec la population hôte. Les chefs de ménages qui font des achats réguliers et sans faille deviennent vite des clients confiants auprès des vendeurs à cause de leur pouvoir d’achat. Ce statut de client référencié, donne à ces derniers des avantages notamment pour faire des achats alimentaires à crédit/Emprunt de vivre. Cet emprunt de vivre concerne dans la plupart des cas des produits finis : sucre, sardine, sel, macaroni etc.…Acheter la nourriture à crédit est donc une stratégie développée par les ménages en période de difficulté alimentaire. Elle est utilisée par 27% des ménages enquêtés. Cette stratégie met les ménages dans le cercle vicieux de l’endettement et constitue un risque élevé d'érosion des moyens de subsistance.
2.2.5. Utilisation de l’épargne des ménages pour l’achat des aliments
Les ménages qui ont su vite développer les capacités de résilience économique, disposent des épargnes considérables pour faire face à la vulnérabilité alimentaire. L’épargne de ces ménages dérive des emplois journaliers (mototaxi, contrat humanitaire etc.) réalisé au sein du camp. Dans tous les camps du département, ces activités existent et aident suffisamment les ménages à disposer d‘important épargne pour se procurer parfois une alimentation équilibrée. Mais, malheureusement pendant la période de soudure (juillet et aout), 10% des ménages épuisent leurs économies en monnaie ou en nature pour se nourrir en cas de pénurie alimentaire. Cette stratégie accentue la vulnérabilité des ménages et entraine souvent des conflits conjugaux si la gestion n’est pas appréciée par le mari.
2.2.6. Déstockage d’animaux
Certains ménages possédant du bétail, vendent quelques têtes pour subvenir à leurs besoins. Pour les périodes de difficultés alimentaires, 6% de ces ménages en vendent plus que d’habitude. Ceci impacte négativement sur le troupeau et provoque une dégradation des moyens de subsistance. La photo 1 présente un aperçu de la vente du bétail sur le marché du camp des réfugiés. La stratégie de vente de bétail est nécessaire pour les ménages qui pratiquent l’élevage et pour ceux qui ne disposent pas de ce privilège, d’autres stratégies s’imposent comme la récolte des cultures immatures. Si le déstockage d’animaux est un moyen d’existence le plus adéquat dans certains ménages qui disposent de bétail (Photo n°1).
Photo n°1 : Vente de bétail sur le marché du camp par une réfugiée et son fils
Source : Care-Goré 2019
Ce ménage du camp de Gondjé, à cause des difficultés alimentaires est obligé de venir vendre deux de ses chèvres sur le marché du camp pour en avoir au retour, le sorgho ou d’autres produits alimentaires nécessaire à leur survie.
2.2.7. Récolte des cultures immatures par la communauté des camps des réfugiés
Le mois d’Août est caractérisé par une difficulté d’accès à la nourriture. 11% de ménages purement agricoles, par manque de nourriture, récoltent les cultures à l’état « vert » pour la consommation ou même pour la vente. La récolte de ces cultures immatures concerne beaucoup plus : l’arachide, le haricot, le maïs, la canne à sucre, la patate et le concombre. Cette stratégie ne tient pas compte de la taille du ménage et entraine chez les enfants le phénomène de vol, si le ménage ne possède pas un champ des produits précités.
2.2.8. Vente des biens non productifs
L’on considère les réfugiés comme des personnes dépourvues de richesse que l’on peut aussi croire. Or il en ressort de nos enquêtes, qu’au sein de la communauté réfugiée du département, il existe des ménages autant fortunés que ceux des autochtones. Ces derniers possèdent des objets de luxe : moto, vélo, téléphone portable, bijoux etc. Dans le cas où la situation alimentaire devient critique au sein de leur ménage, 7% des chefs de ménage affirme avoir vendu parfois ces objets de « luxe » qu’ils possèdent pour se procurer de la nourriture. Tout de même, cette stratégie n’est jamais régulièrement utilisée puisque ces ménages s’organisent du mieux possible pour faire face à la vulnérabilité alimentaire dans la nya-pendé. Les ménages les plus vulnérables vont jusqu’à envoyer leurs enfants mendier sur les places publiques des camps. Cette stratégie met à mal la dignité de ces derniers (Graphique n°3).
Graphique n°3 : Les différentes stratégies utilisées par les ménages pour faire face à l’insécurité alimentaire
Source : Enquête de terrain, 2019
Cette figure montre que la stratégie de la vente des biens productifs (31%) est la plus pratiquée par les ménages ensuite celle de l’achat des biens alimentaires à crédit (28%). Les ménages font également recours à la récolte précoce des cultures immatures (11%), utilisent leur épargne (10%), procèdent à la vente des biens non productifs (8%) et dans une moindre mesure à la mendicité (1%).
A l’issu de ces résultats, nous avons ressorti la proportion des ménages utilisant les différentes stratégies par camps. Ces pourcentages permettent d’appréhender au mieux dans quels camps les différentes stratégies sont le plus appliquées par les ménages enquêtés (Graphique n° 4).
Graphique n°4 : Proportion des ménages enquêtés utilisant les différentes stratégies par Camps
Source : Enquête de terrain, 2019
D’après cette figure, les stratégies tels que, le « recours à la mendicité » (100%), la « récolte des cultures immatures » 44% sont plus perceptibles dans le camp de Dosseye que dans les trois autres du département. Aussi, en égalité de 50% avec le camp de Doholo, sur la stratégie de la « vente des biens non productifs ». Les stratégies de « déstockage d’animaux » (60%) et de « vente des produits productifs » (44%) sont plus développées dans le camp de Doholo ainsi que la stratégie de « vente des biens non productifs » (50%). Les stratégies de « dépense d’épargne » et d’« achat à crédit de la nourriture » sont fréquemment utilisées dans le camp de Gondjé. Tandis que, le camp d’Amboko a recours à l’ensemble des stratégies développées
À côté de ces moyens de subsistances et stratégies d’adaptations précitées, il existe des conséquences sociales de la sous-alimentation enregistrées au sein des ménages réfugiés. Ils sont pour les bénéficiaires un phénomène assez difficile et compliqué à maitriser au sein de leur ménage respectif. La sous-alimentation des ménages, quel que soit sa forme se manifeste beaucoup et surtout en période (Juillet-Août) lorsque les réserves sont épuisées. Elle entraine un phénomène de malnutrition chez les enfants de 0-5 ans dans 10% de ménages.
Pendant les périodes de soudure, d’autres facteurs de vulnérabilités sont perceptibles. Les infections saisonnières (paludisme et diarrhée) sont courantes dans le département. Non seulement, elles provoquent une crise sanitaire mais fragilisent aussi l’état nutritionnel des membres du ménage. Près de 95 % des enquêtés prennent un repas par jour et deux repas pour 5% des ménages aisés. Les conflits familiaux liés à la mauvaise gestion des stocks céréaliers naissent, 53% des femmes reprochent à leurs maris de vendre les stocks pour acheter des boissons alcoolisées contre 46 % des hommes qui le font à l’endroit de leurs épouses.
Conclusion
Conclusion
Au terme de cette recherche, la vulnérabilité alimentaire dans les ménages des populations réfugiées est une réalité. En effet, la cause principale de cette vulnérabilité alimentaire demeure structurelle et conjoncturelle. L’on relève ici une nouvelle stratégie alimentaire du PAM de moins en moins déficitaire, de faibles rendements agricoles dus à la rareté des pluies annuelles, à l’inondation et aux usages des moyens de production rudimentaire. Face à ces facteurs, les populations vulnérables exercent des emplois multiples afin de diversifier leurs sources monétaires basées sur l’échange. Ces derniers développent des moyens de subsistance non stables, non durables (agriculture, élevage, commerce, chasse) et des stratégies de survie qui sont parfois faibles et inefficientes. Notamment, la vente des biens productifs, l’achat à crédit, les dépenses de l’épargne, le déstockage d’animaux, la récolte des cultures immatures, la vente des biens non productifs et le recours à la mendicité. Il faut donc une consécration adéquate de la synergie entre les autorités locales, les institutions spécialisées et la population locale. Cependant, les réfugiés doivent bénéficier d’un accès aux avancées technologiques agricoles, afin d’augmenter le rendement et la qualité de leurs produits. Ils doivent également bénéficier d’un accès accru aux services financiers. Ces perspectives permettront de mettre sur pied une politique de développement agricole durable, efficiente et intégrée afin de minimiser les principaux facteurs locaux de la vulnérabilité alimentaire. Ainsi, une démarche participative impliquant toutes les populations locales dans la mise en œuvre des stratégies de gestion durable de l’insécurité alimentaire s’avère enfin nécessaire. En travaillant ensemble, les populations vont assurer leur sécurité alimentaire, leur autosuffisance durable, et contribuer à la stabilité, la prospérité et la paix dans l’ensemble de la communauté.
Références
Références bibliographiques
ADAHA Dodzi Tagbedji Romaric, 2009, Approches de solutions durables de prises en charge des réfugiés en situation d’asile : le cas du Bénin, mémoire, université d’Abomey.122 p.
ATANGA Armand, 2014, Variabilité et adaptation de l’agriculture paysanne en milieu forestier : cas de la commune de Bikok de 1970 à 2005, Mémoire de Master, Université de Yaoundé I, 159 p.
CATTIN Benoit Michel, et DORIN Bruno, 2012, Disponible alimentaire et productivité agricole en Afrique subsaharienne in Cahiers Agricultures, 21 (5) : p. 337-347.
BERTHIER Nicole, 2010, Les techniques d’enquête en sciences sociales : Méthodes et Exercices corrigés, paris, 4e édition 350 p.
CAMBREZY Luc, 2006, Territoire et dimension géopolitique de l’accueil des réfugiés, Natures, in : Sciences et Sociétés, 11p.
CLOCHARD Olivier, et MOHAMMED Kamel Doraï, 2005, Aux frontières de l’asile : les réfugiés non palestiniens au Liban, a contrario, vol.3, n°2, p.45-65
ECHO, 2016, Enquête de sécurité alimentaire en situation d’urgence concernant l’afflux des nouveaux réfugiés centrafricains au sud du Tchad. Rapport, 15p
FAO-Rome, 2012, Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire : Preuves et normes pour de meilleures décisions en sécurité alimentaire. Manuel technique IPC version 2.0, partenaires globaux IPC.
GIRARD Christian, 2017, Vulnérabilité et stratégies de subsistance des microentrepreneurs et leurs ménages dans les quartiers populaires de Yaoundé, au Cameroun. Thèse de doctorat/Ph.D en Aménagement. Université de Montréal. 345 p.
GUMUCHIAN Herve et MAROIS Claude, 2000, Initiation à la recherche en Géographie. In : Géocarrefour, vol. 75, n°4. L'interface nature-sociétés dans les hydrosystèmes fluviaux. 346 p.
MABOURI Léa, 2018, Évaluation de l’accès et de la qualité de la consommation alimentaire des ménages dans le camp des réfugiés de Minawao, Mémoire de fin de formation, ISS, Maroua, 90 pages.
N’DA Léon, 2014, Sécurité alimentaire et Stratégies des résiliences des ménages en Côte d’Ivoire : cas de la région Ouest, article 5e colloque international Abidjan, du 3 au 4 décembre, 14 p.
NANDJIGUEM Henriette, 2019, Analyse des stratégies d’adaptation des ménages face à l’insécurité alimentaire suivant les zones agro climatiques du Tchad. Mémoire de master, ISSEA, Yaoundé, 88 pages.
NJIEMBOKUE Ginette Octavie, 2015, Insécurité alimentaire en milieu forestier Camerounais, Mémoire de Master, Université de Yaoundé I, 160 p.
OUEDRAOGO Denis, KABORE Moussa, et KIENOU Blaise, 2007, « Insécurité alimentaire, vulnérabilité et pauvreté en milieu rural au Burkina : une approche en termes de consommation d’énergie », n°140 dans Monde en Développement, p.65-84.
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE (PAM), 2016, Manuel d’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence, Deuxième édition.
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE (PAM)-Rome, 2018, Projet de plan stratégique de pays-Tchad (2019-2023), Conseil d'administration, deuxième session ordinaire.
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE (PAM)-Tchad, 2017, Rapport, Plan de réponse national à l’insécurité alimentaire.
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (UNHCR), 2014, Stratégie globale pour les moyens de subsistance : Une stratégie du HCR pour 2014-2018 Rapport, 27p.
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (UNHCR), 2016, Mission d’évaluation conjointe HCR/PAM de la situation des réfugiés centrafricains et Soudanais au Tchad. Rapport, 42p.
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (UNHCR), 2018, Plan de réponse urgence sud réfugiés centrafricains (départements de monts de lam, Nya-Pendé, Beboto, Goré-Tchad). Rapport, 45p.
Downloads
Publié
Comment citer
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=203
Numéro
Rubrique
Qui sommes-nous ?
Licence
Copyright (c) 2023 MEDIEBOU CHINDJI et KANDE Noël