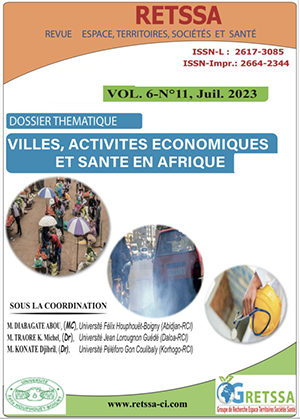- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES PERSONNES DU TROISIÈME ÂGE EN AFRIQUE : DÉFIS ET PERSPECTIVES DE SOLUTIONS Ouvert
- ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET SANTÉ EN AFRIQUE Ouvert
- Voir les précédents appels à contribution
À propos du RETSSA
La Revue Espace, Territoires, Sociétés, Santé (RETSSA) est une revue semestrielle à dimension internationale, pluridisciplinaire et thématique. Chacun de ses numéros présente un dossier thématique, tout en ouvrant ses portes à des textes hors dossier, au travers de la rubrique « Varia » dans laquelle peuvent être publiés des articles se rapportant aux différentes rubriques de la revue. RETSSA est créée en 2017 par le Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés, Santé (GRETSSA) de l’Institut de Géographie Tropicale de l’Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, siège de sa publication. RETSSA est destinée aux scientifiques dont les axes de recherches concernent les thématiques contenues dans le titre de la Revue scientifique. La mise en relation de différenciations démographiques, sociales, spatiales ou territoriales avec la santé publique, menant à l’imbrication des phénomènes sociaux, démographiques et spatiaux et leurs interactions constituent des objets d’études pour des géographes, des démographes, des sociologues, des ethnologues, des historiens, des politologues, des économistes, des environnementalistes, des épidémiologistes, des entomologistes, etc… La mise en commun des résultats d’étude par des chercheurs venant d’horizons disciplinaires et géographiques divers sur un même thème par la RETSSA dans une même publication, est une offre de plateforme de rencontres et d’échanges nécessaires à l’amélioration de la connaissance d’un domaine situé à la croisée de plusieurs sciences sociales et humaines.
Indexation
Indexation en cours
ISSN-L: 2617-3085
ISSN-Impr: 2664-2344
Dernier numero en ligne
VOL.6-N° 11, Juil. 2023 , Publié le 31 Juillet 2023
Articles du dossier thématique
-
QUALITE DES EAUX DE BOISSONS ENSACHEES CONSOMMEES DANS LA VILLE DE PARAKOU AU NORD-EST DU BENIN QUALITY OF BAGGED DRINKING WATER CONSUMED IN THE CITY OF PARAKOU IN NORTH-EAST BENIN
-
ACTIVITES DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET RISQUES DE SANTE SUR LE TRONCON AGBAN-CARREFOUR ZOO (ABIDJAN-CÔTE D’IVOIRE) AUTOMOTIVE MECHANICAL ACTIVITIES AND HEALTH RISKS ON THE AGBAN-CARREFOUR ZOO SECTION (ABIDJAN-CÔTE D’IVOIRE)
-
PRODUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS SOLIDES ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LA VILLE DE BAFANG AU CAMEROUN PRODUCTION OF SOLID HOUSEHOLD WASTE AND ENVIRONMENTAL AND HEALTH RISKS IN THE CITY OF BAFANG IN CAMEROON
-
PRATIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES STATION-SERVICES DANS LA VILLE DE NGAOUNDÉRÉ : ENTRE RISQUES ET POLLUTION ÉNVIRONNEMENTALE PRACTICE OF ECONOMIC ACTIVITIES AT SERVICE STATIONS IN THE CITY OF NGAOUNDERE: BETWEEN RISKS AND ENVIRONMENTAL POLLUTION
-
ACCÈS Á L’EAU POTABLE DANS DEUX QUARTIERS SOUS-INTEGRES DE LIBREVILLE : IMPACTS SUR LA SANTÉ DES ENFANTS ACCESS TO DRINKING WATER IN TWO SUB-INTEGRATED NEIGHBOURHOODS OF LIBREVILLE: IMPACTS ON CHILDREN’S HEALTH
-
L’ESSOR DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE A DOUALA (CAMEROUN) THE RISE OF TRADITIONAL MEDICINE IN DOUALA (CAMEROON)
-
COMMERCE AMBULANT DE L’EAU DE BOISSON ET RISQUE SANITAIRE TRADE IN DRINKING WATER AND HEALTH RISKS
Varia
-
QUALITE DES EAUX DE BOISSONS ENSACHEES CONSOMMEES DANS LA VILLE DE PARAKOU AU NORD-EST DU BENIN QUALITY OF BAGGED DRINKING WATER CONSUMED IN THE CITY OF PARAKOU IN NORTH-EAST BENIN
-
ACTIVITES DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET RISQUES DE SANTE SUR LE TRONCON AGBAN-CARREFOUR ZOO (ABIDJAN-CÔTE D’IVOIRE) AUTOMOTIVE MECHANICAL ACTIVITIES AND HEALTH RISKS ON THE AGBAN-CARREFOUR ZOO SECTION (ABIDJAN-CÔTE D’IVOIRE)
-
PRODUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS SOLIDES ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LA VILLE DE BAFANG AU CAMEROUN PRODUCTION OF SOLID HOUSEHOLD WASTE AND ENVIRONMENTAL AND HEALTH RISKS IN THE CITY OF BAFANG IN CAMEROON
-
PRATIQUE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES STATION-SERVICES DANS LA VILLE DE NGAOUNDÉRÉ : ENTRE RISQUES ET POLLUTION ÉNVIRONNEMENTALE PRACTICE OF ECONOMIC ACTIVITIES AT SERVICE STATIONS IN THE CITY OF NGAOUNDERE: BETWEEN RISKS AND ENVIRONMENTAL POLLUTION
-
ACCÈS Á L’EAU POTABLE DANS DEUX QUARTIERS SOUS-INTEGRES DE LIBREVILLE : IMPACTS SUR LA SANTÉ DES ENFANTS ACCESS TO DRINKING WATER IN TWO SUB-INTEGRATED NEIGHBOURHOODS OF LIBREVILLE: IMPACTS ON CHILDREN’S HEALTH
-
L’ESSOR DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE A DOUALA (CAMEROUN) THE RISE OF TRADITIONAL MEDICINE IN DOUALA (CAMEROON)
-
COMMERCE AMBULANT DE L’EAU DE BOISSON ET RISQUE SANITAIRE TRADE IN DRINKING WATER AND HEALTH RISKS